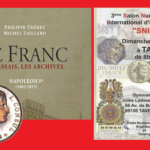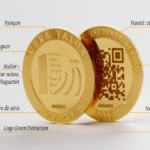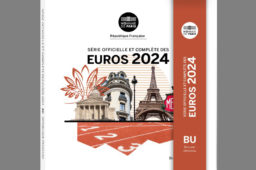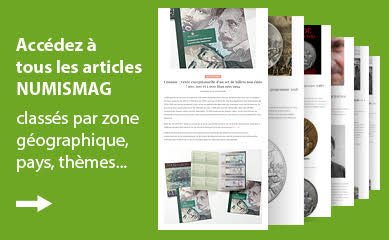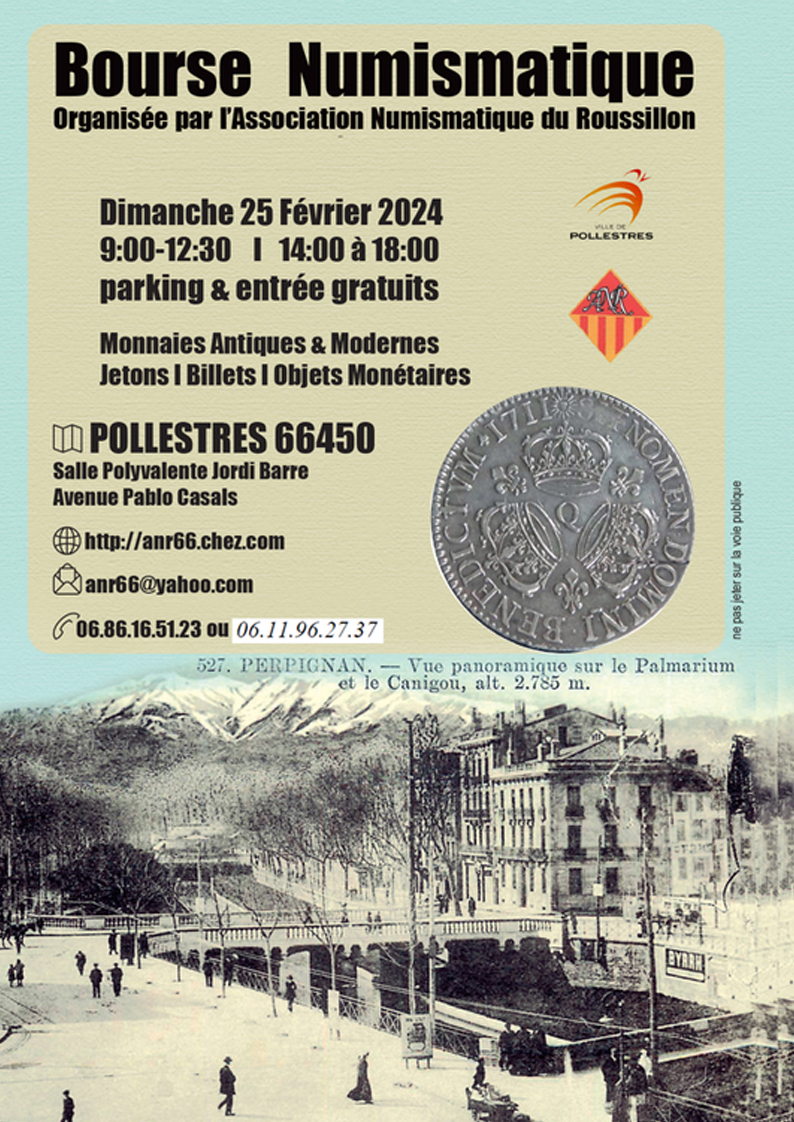Le Franc dans la tourmente – L’économie de la France de 1914 à l’Armistice en 1918
- novembre 04, 2018
- par
- Olivier



L’année 2018 a été marquée par de grandes manifestations avec pour point d’orgue les cérémonies du 11 novembre 2018, commémorant les 100 ans de l’armistice. Sans parler du drame humain lié à ce conflit, la France sortit exsangue financièrement avec des conséquences considérables qui pèseront sur le pays au cours des deux décennies suivantes. Au commencement de cette guerre, dont les conditions étaient réunie dès 1912, il y eu l’assassinat de l’archiduc d’Autriche François Ferdinand à Sarajevo. Sa mort va fournir le prétexte ultime qui permit au conflit d’éclater. La France mobilisera près de 3 millions d’hommes dès Août 1914. Ce chiffre se porté à 5 millions en 1918.
Dès le début des années 1910, la Banque de France s’était préparée à l’éventualité d’un conflit. Dans un contexte international où l’or occupe une place dominante, elle s’était efforcée d’accroître le montant de son encaisse or. Celui-ci atteindra 4,1 milliards de francs à la veille de la guerre.

OOO
Le début du conflit va provoquer la fermeture, dès fin du mois de juillet 1914, de 47% des entreprises françaises, avec la mise au chômage de 2 millions de français non mobilisables! Du fait de ces fermetures forcées, les cours de la bourse s’effondrent du fait d’une avalanche d’ordres de vente affluants sur les marchés. Malgré une demande d’aide, la Banque de France refusera dans un premier temps son aide financière aux agents de change qui réclamaient 500 millions de Francs. La BdF finira plus tard par leur apporter tout de même 250 millions de francs.

Les Parisiens se masse devant la Banque de France, 39 Rue Croix des Petits Champs à Paris – Juillet 1914
Dans les jours qui précédent la déclaration de guerre, les établissements bancaires et les caisses d’Epargne ont été submergées par les demandes de retraits des Français. Malgré l’aide apportée par la Banque de France, l’État sera obligé d’instituer un moratoire avec une clause de sauvegarde qui limitera les retraits à 50 francs par quinzaine dans les Caisses d’Epargne. Le moratoire sera étendu dès le 9 août à l’ensemble des dépôts bancaires. Il sera assoupli progressivement jusqu’à la possibilité d’un retrait total des dépôts à partir de décembre 1914. De plus, des rumeurs circulèrent sur les difficultés de la Société Générale, mais heureusement, il n’y eu aucune faillite des principales grandes banques françaises.

Des français font la queue devant la Caisse d’Epargne dans l’espoir de pouvoir recupérer leurs fonds – Juillet 1914
Durant tout le conflit, la Banque de France sera particulièrement sollicitée, notamment par l’État, pour des avances. Cette aide commencera par un versement de 2,9 milliards nécessaires à la mobilisation générale. Cette avance au trésor public sera portée à 27 milliards en 1918. Le gouvernement prendra très vite conscience qu’il ne pourra plus demander à la BdF de multiplier ses avances financières sans la mettre en danger. Il fallait donc prendre de nouvelles mesures pour soutenir les dépenses considérables que ce conflit allait provoquer.
OO
Les mesures monétaires d’août 1914
Afin de soutenir l’effort de guerre, qui demande un financement largement supérieur au budget d’avant-guerre, l’État devra alors innover en mettant en place plusieurs stratégies:
Faire fonctionner la planche à billets revient à ce que la Banque de France effectue des avances à l’État, sous contrôle du Parlement. Cela aura pour conséquence de créer une inflation galopante et une forte augmentation des prix.
Les Emissions de Bons du Trésor sont un placement de titres à court terme (3 mois, 6 mois et 1 an) appelés alors « Bons de la Défense Nationale ». Ils seront un des moyens de financement les plus important de l’effort de guerre.
Pour enrayer l’érosion des réserves en or qui menacent la crédibilité du franc, une « campagne de l’or » est lancée. Elle permettra de compenser les ventes de métal précieux. Pour cela, l’État demandera aux français de céder leur or contre des billets de banque avec délivrance d’un reçu attestant du civisme des déposants. La valeur du franc étant divisée par 5 en 10 ans, ces bons s’avèreront particulièrement ruineux pour ceux qui auront ainsi converti leur or en billets de banque.
Pour finir, le gouvernement émettra des emprunts à long terme perpétuels, non remboursables et portant un taux d’intérêt. Quatre grands emprunts nationaux seront lancés durant la guerre.
OO
Les émissions monétaires de La période 1914 1918
Les billets qui avaient cours lors de la guerre
La guerre implique un effort colossal de production monétaire : de 21 millions de billets imprimés en 1910, la production passe à 75 millions en 1914 et à 190 millions en 1915. L’encaisse or passera de 70% de la valeur globale des billets en 1913 à 28% fin 1918.
La guerre affectera lourdement les finances du pays avec une évolution dans l’usage quotidien des monnaies. La première guerre mondiale va donner lieu à l’émission d’une nouvelle gamme de billets dont les thèmes patriotiques traduisent bien les préoccupations du moment.
Jusqu’en 1914, sur le plan strictement financier, le volume de billets émis, qui représente la masse monétaire papier, ne sera que très rarement couvert par l’encaisse or déposée à la Banque de France : durant cette période, et contrairement à la légende, les réserves d’or française, à l’instar de celles de la Grande-Bretagne ou plus tard des États-Unis, couvrent en moyenne 5 % à 10 % de cette masse.
De plus, des conventions passées avec le gouvernement, prévoient la suspension de la convertibilité des billets et un relèvement du plafond d’émission en relation avec un relèvement des avances au gouvernement.
OOO
Cinq Francs Bleu type 1905

Cinq francs Bleu du 31 octobre 1916
La production passa de 12 500 millions billets en 1914, à 140 millions en 1915 et jusqu’à 146 millions de billets en 1916
ooo
Cinq francs Violet type 1915
Hautement symbolique dans ce contexte, la figure d’une femme casquée illustre le billet de 5 francs créé en 1917 en remplacement du 5 francs bleu. Le filigrane renforce ce caractère symbolique avec une figure de jeune guerrier inspirée de la composition de François Rude, la Marseillaise, qui orne l’arc de triomphe place de l’Etoile.

La production passa de 50 millions billets en 1917, à 122 400 millions en 1918
OOOooo
Dix francs Bleu Minerve type 1915
Coupure de 10 francs à l’effigie de Minerve, déesse de la Sagesse mais aussi déesse guerrière qui apparaît casquée sur ce billet

Production de 60 600 millions billets en 1916, 61 millions en 1917 puis de 175 millions en 1918
OOO
Vingt francs Bayard type 1916
Cette coupure de 20 francs est illustrée du portrait de Bayard, le chevalier « sans peur et sans reproche ». Cette effigie s’inspire d’une médaille de Bayard conservée à la Bibliothèque Nationale. La mémoire populaire, mais aussi des historiens, le considèrent comme le premier héros ayant glorifié la “nation française”. La presse de l’époque relate la grande bravoure au combat du preux chevalier dont les qualités sont innombrables: “hostile au pillage, doux au vaincu, pitoyable aux pauvres gens”. Il symbolise le courage que les soldats doivent montrer face à l’ennemi.

Vingt francs Bayard du 19 novembre 1918
OOOO
Cinquante francs Bleu et rose type 1889

OOO
OOOO
100 francs Merson, type 1906

100 francs Merson, type 1906, modifié 1910, adapté 1917
daté du 11 novembre 1918
Sur le Merson fût ajouté un neuvième chiffre au numéro de contrôle à partir de l’alphabet 4001 autorisé le 2 novembre 1917 mais daté 26 avril 1917, en raison d’un fort accroissement de la production de billets lié à la guerre.
OO
500 francs Bleu et rose type 1888 – 1917

OOO
1000 francs Bleu et rose type 1889 – 1917

OOO
5000 francs Flameng, type 1918
En 1917, le gouvernement français voyez le conflit perdurer au-delà de 1919 voir même 1920. Le franc malmené par la guerre d’une part et par la politique de la planche à billets, allez tout droit vers son effondrement. Le gouvernement anticipant l’hyper-inflation qui allait peut-être en découler, lança la conception d’une nouvelle coupure à forte valeur faciale. C’est à partir du projet de 1000 francs Flameng de 1897, que fût conçu le 5000 francs avec des couleurs plus froides en rapport avec cette période de guerre. La fabrication commença en 1918. Tous les billets sont datés de Janvier 1918. Heureusement le conflit prit fin en novembre de cette année et la France pût éviter l’hyper-inflation comme la connue par la suite la république de Weimar. Le billet fût gardé en réserve et sera émis à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1938.
OO


OOOO
OOOO
OOOLes monnaies qui avaient cours lors de la guerre
La raréfaction des espèces métalliques pour les paiements de faibles montants a provoqué l’apparition de monnaies de nécessité aux formes les plus diverses. Les tirages de pièces d’argent augmenteront significativement pendant le conflit. De plus l’inflation galopante aura fini de faire disparaitre les petites valeurs de 1 et 2 centimes dès 1920. Les pièces et tirages présentés ci-dessous concernent uniquement les frappes de 1914 à 1918.
OOOO
1 centimes Dupuis

Frappe de 1914 : 1 000 000 ex
Frappe de 1916 : 1 995 900 ex
OOO
2 centimes Dupuis

Frappe de 1914 : 2 000 000 ex
Frappe de 1915 : 500 000 ex
OOOO
5 centimes Dupuis

Frappe de 1914 : très peu
Frappe de 1917 : 10 453 389 ex
Frappe de 1918 : 35 591 616 ex
OOO
5 centimes Lindauer

Frappe de 1914 : 6 000 000 ex
Frappe de 1915 : 4 362 468 ex
Frappe de 1916 : 22 477 154 ex
Frappe de 1917 : 11 913 589 ex
Frappe de 1918 : sans
ooo
10 centimes Dupuis

Frappe de 1914 : 6 000 000 ex
Frappe de 1915 : 4 362 468 ex
Frappe de 1916 : 22 477 154 ex
Frappe de 1917 : 11 913 589 ex
Frappe de 1918 : sans
OOOO
10 centimes Lindauer

Frappe de 1917 : 8 171 364 ex
Frappe de 1918 : 30 605 494 ex
OOO
25 centimes Lindauer

Frappe de 1914 : 941 133 ex
Frappe de 1915 : 532 237 ex
Frappe de 1916 : 99 608 ex
Frappe de 1917 : 3 149 759 ex
Frappe de 1918 : 18 329 894 ex
OOO
50 centimes Semeuse par Oscar Roty

Frappe de 1914 : 9 656 841 ex
Frappe de 1915 : 20 892 772 ex
Frappe de 1916 : 52 962 657 ex
Frappe de 1917 : 48 628 732 ex
Frappe de 1918 : 36 491 942 ex
OOO
1 franc Semeuse par Oscar Roty

Frappe de 1914 : 14 361 102 ex
Frappe de 1914C : 43 421 ex (Frappe à Castelsarrazin)
Frappe de 1915 : 47 955 158 ex
Frappe de 1916 : 92 029 179 ex
Frappe de 1917 : 57 153 034 ex
Frappe de 1918 : 50 112 330 ex
OOO
2 francs Semeuse par Oscar Roty

Frappe de 1914 : 5 718 526 ex
Frappe de 1914C : 461 647 ex (Frappe à Castelsarrazin)
Frappe de 1915 : 13 963 409 ex
Frappe de 1916 : 17 886 653 ex
Frappe de 1917 : 16 55 357 ex
Frappe de 1918 : 12 026 147 ex
O
OO
10 francs Or

Dernière Frappe en 1914 : 3 041 435 ex
OOOO
20 francs Or
Dernière Frappe en 1914 : 6 517 782 ex
OOO
La création des bons de la défense nationale
Pour que les français adhèrent au principe des Emissions de Bons du trésor, appelé « bons de la défense nationale », il fallait leur offrir des conditions d’une grande simplicité que tout le monde puisse comprendre. Les bons seront affranchis de tout formalisme quant à délivrance à leur remboursement. Les souscripteurs seront dispensés de se faire connaître et pourront bénéficier des guichets des agents des finances, mais aussi ceux de tous les bureaux de poste. Le gouvernement organisera des campagnes de publicité qui en feront la promotion durant tout le conflit.
Le 13 septembre, au Conseil des ministres autorisa d’émettre des bons à trois mois, à six mois ou à un an, portant un intérêt de 5 %, payable d’avance au moyen d’une réduction du prix du bon, de sorte que pour un bon à un an de 100 francs l’acheteur n’aurait à débourser que 95 francs. Les intérêts de 5 % furent réduits par la suite, à 4,5 % pour les bons à 6 mois, et à 4 % pour les bons à 3 mois. Il fût maintenu à 5 % pour les bons à un an. Pour limiter les effets néfastes des bons comme l’augmentation de l’inflation fiduciaire ou la contribution à la hausse générale des prix, il fût créé des bons à un mois qui, s’ils ne sont pas présentés à l’échéance, deviennent des bons à vue, productifs d’un intérêt de 3,60 %.

Dépliant de la Banque de France pour l’émission des bons de la défense nationale – Juillet 1916

Il sera émis des bons de 5, 25, 100, 500 et de 1 000 francs. Les bons devrons être au porteur et ne seraient susceptibles d’aucune opposition. Ils pourraient donc passer de main en main avec la même facilité qu’un billet de banque.



Bons de la défense nationale de 1000 francs – 1918
ooo
Petites économies des travailleurs et des domestiques, placements temporaires des rentiers, réserves des agriculteurs en quête de l’achat d’une terre, fonds de roulement des commerçants et des industriels, disponibilités des banques qui ont trouvé un moyen commode de faire valoir les fonds qui leur sont confiés en dépôt ou en compte courant, voilà les mille sources d’où sont arrivés au Trésor ces milliards indispensables pendant la guerre et encore nécessaires après la guerre.
En novembre 1915, le montant de bons émis atteindra 9 milliards de francs. En 1918 c’est plus 30 milliards de francs de bons de la Défense national qui seront détenus par le contribuable français.
Les monnaies de nécessité
La monnaie divisionnaire, conservées par les particuliers ou réquisitionnées par l’Etat, ne tardèrent pas à manquer.

Pour faire face à cette disparition qui menaçait de paralyser les échanges quotidiens, des monnaies, dites de nécessité, furent mises en circulation par des commerçants, des municipalités ou des chambres de commerce. De faibles valeurs faciales, ces pièces ou billets, présentent une grande diversité de types et sont fabriquées dans des matériaux variés comme l’aluminium, le laiton, le fer, le papier et même le carton.





OOO
OOO
Les bons de monnaie de la Trésorerie aux armées ou le billet du poilus
En 1917 et 1919, la Trésorerie aux armées émettra des bons de monnaie à circulation forcée dans les zones militaires. Ces bons de monnaie de 0,50, 1 et 2 francs circuleront en France, uniquement dans les zones de combat. Ils serviront à éviter que les monnaies d’argent divisionnaires type Semeuse, de même valeur ne tombent entre les mains de l’ennemi et ne soient fondues et revendues au prix du métal précieux. Ils servirent aussi au remplacement des bons communaux émis dans les régions occupées par les Allemands.
Une première série de coupures de 0,50, 1 et 2 francs fut émise en 1917 avec la notion de remboursement dans les 2 ans qui suivront la cessation des hostilités. Le conflit durant plus longtemps que prévu, la deuxième série, émise en 1919, vit le délai de remboursement porté à 4 ans. Sauf pour le billet de 2 francs qui ne fut réimprimé.

50 centimes Trésorerie aux Armées 1917
Le dessin représente le retour d’un poilus, une mère et son enfant tendant les bras vers son époux. En filigrane, une abeille encadré par la lettre C.
Ces billets ont été fabriqués par l’Imprimerie Nationale

2 francs Trésorerie aux Armées 1917, non émis
OOO
Versement d’Or pour la défense nationale
Donnez votre Or !
Durant les premiers mois de la guerre, la France peut faire face à ses règlements extérieurs grâce aux avoirs en devises qu’elle détient à l’étranger. Mais peu à peu, les envois d’or commencent à être indispensables. Les membres de la Banque de France estime qu’il serait imprudent d’épuiser trop rapidement la possibilité que la Banque a pour emprunter à l’étranger en hypothéquant ses ressources en or.
C’est ainsi que sera mis en place la collecte de l’or pour permettre à la France de faire face à ses règlements. Les Français seront mis a contribution dès 1915. Le total des versements d’or pour 1915, atteindrons 1 047 231 000 francs !
OOO

OOO

Certificat de Versement d’or pour la Défense Nationale – modèle de 1915
OOO
La campagne sera relancée en 1916. Un nouveau modèle de certificat sera présenté dans la presse en avril 1916. Il reprend le graphisme du premier billet émis par la Banque de France en 1800. Le 1000 francs germinal.

Versement d’Or pour la défense Nationale – 1916

OO

Certificat de donation d’Or – 1915
OOO
Le 12 novembre 1918, le montant total des versements d’or depuis le début des hostilités s’éleverons à :
2 356 154 000 de francs
Le 12 novembre 1918 le montant total de OOO
OOOO
Les grands emprunts nationaux
La durée du conflit ainsi que le montant important de dette à court terme pousse par la suite le Trésor à émettre des titres à long terme. L’épargne française sera de nouveau mise à contribution par le biais de 4 grands emprunts nationaux annuels (novembre 1915, octobre 1916, 1917 et 1918). Ces initiatives répondaient à une double nécessité. Il s’agissait d’abord, de financer une guerre rendue particulièrement coûteuse par l’effet combiné de sa longueur, de l’ampleur des moyens nécessaires et de son caractère industriel. Mais cet enjeu coexiste avec un autre, celui de la mobilisation de la société dans son ensemble.
En enjoignant les populations de souscrire aux emprunts, ou aux bons de la Défense nationale, le gouvernement de l’époque entendaient entretenir l’implication des Français dans la guerre. Le devoir de l’arrière était en effet de seconder les efforts et les sacrifices endurés sur le front par les millions de mobilisés. Pour ce faire, l’État recourt à des moyens de propagande variés, tels que la presse, les conférences, les discours et l’affichage.
Tous les emprunts seront couronnés de succès.

1er Emprunt de novembre 1915

2ème Emprunt d’octobre 1916

3ème Emprunt d’octobre 1917

4ème Emprunt d’octobre 1918
Entre 1914 et 1918, le déficit extérieur cumulé s’élèvera à 40 milliards de francs. Il était donc nécessaire pour le ministère des Finances de se procurer des devises étrangères afin de couvrir les importations du pays. Pour ce faire, il aura recours à des crédits extérieurs pour 30 milliards de francs, à des transferts d’or ainsi qu’à des rachats de titres étrangers détenus par les résidents.
À la fin de la guerre, la dette publique représentera 200% du PIB. Ce poids trop important de la dette empêchera le retour à l’ancienne parité-or du franc et compliquera sa stabilisation dans les années 1920. D’après l’historien Alfred Sauvy, la guerre a entraîné une explosion du rapport dépenses publiques/revenu national, établi en 1921 à 270% et qui ne redescendra à 100% qu’en 1929. Les dépenses liées à la dette ont également augmenté, représentant ainsi 1,6% du revenu national en 1912, 4,9% en 1920 et jusqu’à 7,3% en 1923, à mesure que la reconstruction du pays avançait. Le chantier titanesque de la reconstruction a été financée en partie par les emprunts lancés en 1920-1921, ainsi que par le «crédit national pour la reconstruction» en 1919. L’historien Fernand Braudel estime le coût de la reconstruction à plus de 35 milliards de francs-or, mais certainement en deçà de la réalité.
L’armistice de 1918 est signé le lundi à 5 h 15 à Rethondes, en forêt de Compiègne (Oise). Il sonne la fin des combats de la Première Guerre mondiale, la victoire des Alliés et la défaite de l’Allemagne.

L’Armistice – La foule en liesse place de L’Opéra le 11 novembre 1918

Des soldats français démobilisés heureux d’être enfin de retour chez eux.
OO
Sources : Université de Poitier, Claude Fayette – Les billets de la Banque de France et du Trésor (1800-2002)
Musée Carnavalet : L’art du billet. Billets de la Banque de France 1800-2000, Banque de France/Paris-Musées, 2000, La Banque de France dans la grande Guerre, Musée de Nantes, BHPT (biliothèque Historique des postes et télécomunications).